 L’Alsace et la Moselle bénéficient d’un régime juridique dérogatoire au régime légal français de droit commun, communément dénommé le droit local.
L’Alsace et la Moselle bénéficient d’un régime juridique dérogatoire au régime légal français de droit commun, communément dénommé le droit local.
1/ L’origine du droit local
Un droit local En Alsace et en Moselle, L’Alsace et la Moselle ont pour la première fois été annexées par l’Empire allemand le 10 mai 1871 à l’occasion du traité de Francfort.
A compter de cette date, les lois de l’Empire germanique se sont appliquées sur l’ensemble du territoire de l’Alsace et de la Moselle.
En 1919, l’Alsace et la Moselle ont été réintégrées à l’Etat français par la signature du traité de Versailles. Toutefois les élus de ces trois départements souhaitaient que les lois de la République de Weimar, perçues comme plus favorables pour la population soient conservées, s’agissant selon eux d’une « construction législative originale et moderne ».
Ce principe du maintien des textes antérieurs a été acté dans une loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l’Alsace et de la Lorraine. Deux lois du 1er juin 1924 puis une ordonnance du 15 septembre 1945 ont permis l’intégration effective du droit local dans la législature nationale.
Enfin, le Conseil constitutionnel a reconnu le droit local en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République dans sa décision rendue à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, le 5 août 2011 dans l’affaire « Société SOMODIA« . Désormais, le droit local fait partie du bloc de constitutionnalité.
L’appellation « droit local » recouvre toute une série de règles spécifiques portant sur plusieurs thématiques, notamment en matière de chasse, d’associations, de cultes et congrégations religieuses ou de droit du travail.
Nous détaillons ci dessous quelques-unes des principales règles de droit du travail spécifiques au droit local.
2/ Quelques spécificités du droit local en droit du travail
2-1 La clause de non concurrence
La clause de non concurrence, insérée dans le contrat de travail ou dans la convention collective, vise à limiter la liberté d’un salarié d’exercer, après la rupture de son contrat de travail, des fonctions concurrentes chez un concurrent ou à son propre compte.
Pour être valide, la clause de non-concurrence doit être limitée géographiquement et temporellement, viser une activité précise, faire l’objet d’une contrepartie financière et être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
En droit commun
Les parties fixent librement le montant de la contrepartie financière.
De plus, l’employeur peut à tout moment renoncer à l’application de la clause de non-concurrence en application des conditions prévues par le contrat de travail ou de la convention collective, ou à défaut avec l’accord du salarié. En pratique, l’employeur peut donc décider, au moment de la rupture du contrat de travail, de délier le salarié de toute interdiction de concurrence. En contrepartie, l’employeur n’est plus tenu au versement de l’indemnité de non-concurrence.
En droit local
Le droit local contient quelques particularités sont prévues pour les salariés qualifiés de « commis commerciaux ». Aux termes de l’article 74 du code de commerce local, le commis commercial est « celui qui est employé par un commerçant pour fournir des services commerciaux moyennant rétributions« .
Contrairement au droit commun, le droit local prévoit notamment que :
- La contrepartie est au moins égale à 50 % de la rémunération brute ;
- Cette clause ne peut pas être dénoncée sans préavis. De ce fait : la renonciation de l’employeur entraîne le maintien de la contrepartie due en cas de clause de non concurrence pendant 1 an.
2-2 Le maintien de salaire en cas de maladie
En droit commun
Dans le secteur privé, un délai de carence de 3 jours est prévu avant le versement des indemnités journalières et le maintien du salaire. Pour les jours suivants, un maintien du salaire partiel est prévu par le code du travail (article L. 1226-1), ou par des dispositions conventionnelles.
En droit local
- Pour les commis commerciaux
Les commis commerciaux en arrêt de travail suite à un accident, dont ils ne sont pas fautifs, bénéficient d’un maintien de leur salaire, pour une durée de six semaines. L’ancienneté du commis commerciale est indifférente (article L. 1226-24 du code du travail).
- Pour les autres salariés
Les salariés dont le lieu de travail se situe en Alsace ou en Moselle bénéficient du maintien de leurs salaire à 100 % (sous déduction du montant des indemnités journalières versées par l’employeur) en cas d’absence indépendante de leur volonté (article L. 1226-23 du code du travail) dans la limite d’une durée dite « relativement sans importante » appréciée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Le maintien de salaire est de surcroît effectif dès le premier jour d’absence du salarié, et donc sans délai de carence.
A titre illustratif, le maintien de salaire d’un salarié absent pour raison médicale ou pour un motif lié à la maternité d’une durée de 10 semaines ayant une ancienneté de quasiment 5 ans, a été jugé conforme aux critères énoncés.
Enfin, aucune contre-visite médicale n’est prévue en droit local.
Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez également lire notre article : « Droit local : le maintien de salaire est maintenu« .
2-3 Le repos dominical et les jours fériés
En droit commun
11 jours sont fériés en France. Seul le 1er mai est obligatoirement chômé. S’agissant du repos dominical, de nombreuses dérogations sont prévues. Notons notamment que certaines activités bénéficient d’une dérogation permanente de droit (article R. 3132-5 du code du travail)
En droit local
L’Alsace et la Moselle comptent 13 jours fériés !
En droit local, les dimanches et jours fériés sont en principe tous chômés.
Quelques dérogations de droit commun peuvent s’appliquer en Alsace. Dans les industries ou les entreprises industrielles fonctionnant en continu (article L. 3134-1 et L. 3132-14 du code du travail) et dans celles ayant mis en place des équipes de suppléances, le droit local renvoie ainsi aux dispositions du droit commun.
En deuxième lieu, quelques dérogations ponctuelles sont permises par l’article L. 3134-5 du code du travail. A titre d’exemple, un salarié peut être amené à travailler un dimanche afin de réaliser un inventaire prescrit par la loi.
Enfin, des dérogations réglementaires et des autorisations préfectorales permettent le travail le dimanche ou un jour férié (articles L. 3134-8 et L. 3134-6).
2-4 Le préavis en cas de démission
Le préavis est l’information officielle que transmet le salarié à son employeur qu’il cesse d’être lié contractuellement avec ce dernier, à l’échéance d’un certain délai (article R 3132-5 du code du travail).
En droit commun
La durée du préavis est régie par les stipulations d’une convention collective, d’un accord collectif, du contrat de travail ou par les usages liés à une profession dans un secteur déterminé
En droit local
Les commis commerciaux, les cadres, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d’un délai de préavis réduit à 6 semaines (article L. 1234-16 du code du travail).
Pour les autres salariés, seul un préavis de 15 jours est exigé (article L. 1234-15 du code du travail)

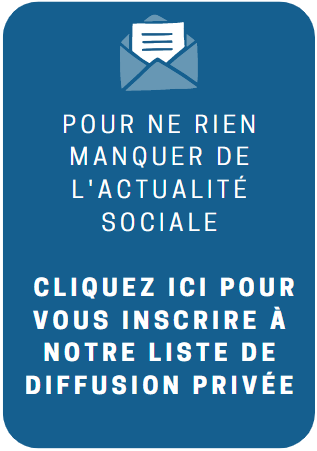
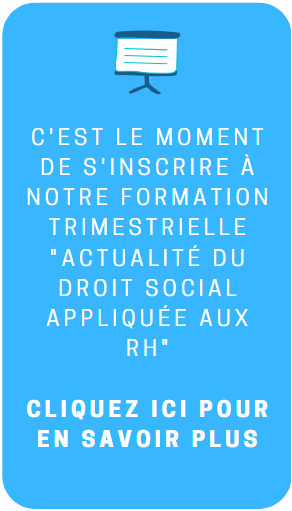
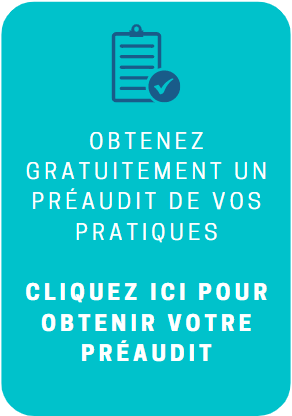
Bonjour,
Pour moi, il y a quand même une légère ambiguité sur ce délai de prévis.
Ma rémunération est fixée par mois et je ne suis pas « chargée de manière permanente de la direction ou la surveillance d’une activité ou d’une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification »(je suis comptable dans un CSP)
Mais mon employeur m’impose 6 semaines de préavis, car sur mon contrat de travail il y a écrit statut « technicien ».
J’ai plus de mal à trouver un nouvel emploi que les autres candidats qui disposent de 15 jours de préavis pour les mêmes qualifications.
Pensez-vous qu’il est possible de passer à 15 jours de préavis en motivant le fait que mon emploi nécessite que des compétences basiques ?
Bonjour,
J’ai demandé un préavis de deux semaine grâce au droit locale mais j’apprends que je suis commis commercial et donc ça doit être 6 semaines. Est-ce obligé ? Pourrai-je le réduire à 2 semaines?
Bonjour,
On vient de me prétendre que le droit local du travail c’est fini et que l’employeur peut tout à fait refuser un préavis de 15 jours au profit de la convention de l’employeur. Est-ce vrai ?
Le droit du travail et le droit local en matière de préavis de départ ne s’appliquent qu’en l’absence de disposition précise de la convention collective ou d’accord collectif dans l’entreprise. Ce principe est applicable également au droit local. C’est la convention qui prime.
J’ai lu par ailleurs que la durée de préavis retenue est toujours celle qui est en faveur du salarié. Si le droit local est plus favorable que la convention collective, il me semble que c’est le droit local qui prime sur la convention collective.
Est-ce qu’un avocat pourrait nous confirmer cela ?
J’aimerais avoir confirmation svp
Je suis en droit local tout en travaillant en Meurthe et Moselle car sous la loi d avant 2011.
Mon employeur dit que mon droit local n est valable que pour le social ( maladie) , mais que je n ai pas le droit aux 2jours fériés ni au seuls 15jours de préavis…qui relève du légal. Il m arrive occasionnellement de travailler en Moselle aussi.
Ne puis je pas bénéficier de tout le droit local?
Je travaille en temps que commercial pour une entreprise basé à Troyes et moi j’habite à Strasbourg
Ai je le droit d’avoir les 2 jours de congés supplémentaires du doit locale
Sachant que je visite des clients dans d’autres département
Merci pour votre réponse
Cordialement
Article exceptionnel !
J’aimerai aussi la réponse à cette question.
Bonjour, je suis conducteur de train chez Fret SNCF, j’ai le statut de cheminot depuis 2014, contrat que j’ai signé en travaillant à Paris. Depuis j’ai été muté :
lieu d’affectation : SOUFFELWEYERSHEIM (67460)
Établissement employeur : usine Alsace Bourgogne Franche-Comté, à Gevrey-Chambertin (21220)
Je vais probablement démissionné dans les mois qui viennent, et j’ai appris que le droit local pour le préavis de démission (de 15jours) ne s’appliquerait pas dans mon cas, et que je devrais donner un préavis d’un mois comme écrit dans mon contrat signé à Paris. Est-ce que c’est le cas ? Si oui, pourquoi ?
Cordialement,
K
Bonjour
Je suis dans la fonction publique
Aesh de métier
CDD de 3 ans mais je dois encore faire 2 ans
Je voulais savoir si j’ai le droit de jouer de la lois local pour ma démission ?
Merci
bonjour
avez vous eu une reponse? je suis dans le meme cas que vous…
merci d avance
julie
Bonjour,
Je suis en arrêt pour burn out depuis le 10 janvier 2020. Jusqu’à présent mon employeur me faisait le maintien de salaire mais passé un arret de 6 mois cela est différent.?
Car j’ai dépassé ce délai et je reçois des indemnités journalières de la cpam qui apparemment couvriront mon salaire a 50%.
Cordialement
Bonjour,
Maintien de salaire de 6 mois c’est déjà pas mal, soit par l’ancienneté soit par courtoisie, mais ne pas oublié de demander a votre employeur de voir avec la prévoyance auquel ils ont l’obligation d’avoir souscrit.
Pendant le maintien de salaire la prévoyance couvre en partis le reste a charge a l’employeur , mais lorsque l’on met fin au maintien de salaire , il faut le reversé au salarié en question.
Beaucoup de société garde cette argent ou ne font pas les démarches nécessaire. Envoyez leur un courrier en A/R leur demandant ou en est votre dossier auprès de la prévoyance.
Bonjour,
je ne suis pas avocat, mais j’aurais tendance à mettre en cause l’employeur, lequel est à l’origine du burn out (si vous avez contacté la médecine u travail ou si ceci est indiqué sur un document médical en votre pàssession) et il s’agit alors d’une maladie professionnelle avec beaucoup d’autres conséquences
Cordialement
Bonjour,
j’ai envoyé ma démission a mon employeur avec le droit local Aslace/Moselle qui me donne le droit à 15Jours de préavis au lieu de 1Mois comme l’exige la convention collective mais mon employeur me le refuse et m’impose 3 semaine a t-il le droit ?
si je quitte ma société après mon préavis de 15jours qu’est-ce que je risque ?
Bonjour je suis infirmière en Moselle dans le privé, j’aimerais bénéficier du droit local avec un préavis de démission réduit à 15 jours au lieu d’un mois prévu dans la convention hors dans le cadre du plan blanc la direction a refusée le préavis de 15 et l’a maintenu à un mois pour des collègues partis avant moi, à -t-elle le droit de refuser l’application du droit local dans le cadre du plan blanc? si je n’applique pas ma durée de préavis d’un mois pour un autre poste que cela implique-t-il? merci
Bonjour je vais faire une cure thermale mon employeur me demande de prendre mes congés payés
le droit local permet d’avoir les indemnités de la sécurité sociale
pouvez vous m envoyé ce texte
merci d’avance
Je suis chargé d’opération ( ingénieur généraliste) dans un bureau d’étude en Maitrise d’œuvre en Moselle,
Dans mon contrat de travail il est spécifié que le préavis est de 3 mois ; est-ce que cela prime sur le droit local?
d’autre part je ne comprends pas dans le droit local qui est obligé de faire 15 jours ou a 6 semaines de préavis .
Merci de votre retour
Bonjour,
Pour une demande de congés sabbatiques, la prise d’effet est à 3 mois normalement, est-ce que le droit local s’appliquant sur le préavis en cas de démission soit 6 semaines, est valable pour le congé sabbatique également.
Bonjour
Je suis directeur d’agence en Alsace depuis 5 ans et mon contrat de travail est établi avec l’adresse du siège du groupe à Paris
Je souhaite démissionner. Mon préavis est-il bien de 6 semaines conformément au droit local ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
y aurait il des éléments propres au droit local qui permettraient de s’opposer à l’obligation vaccinale notamment chez les professions libérales ? Risques sur les contrats de travail des salariés aux seins des cabinets médicaux touchés par l’interdiction d’exercer du praticien employeur réfractaire à l’obligation vaccinale après le 15 septembre etc…..? En effet si le conseil constitutionnel a voulu limiter la portée de la loi sur la gestion de la crise sanitaire dans son impact sur le contrat de travail des salariés réfractaires à l’obligation vaccinale en refusant la rupture de leurs contrats de travail, pourrait-on en déduire que l’on ne pourrait pas empêcher un médecin d’exercer au motif que ce dernier se trouvant dans l’impossibilité d’exercer n’aurait pas d’autre choix que de licencier ses salariés ce qui irait à l’encontre de la volonté initiale du conseil constitutionnel ?
Bien-sûr il existe peut-être d’autres items propre au droit local en la matière qui pourrait s’opposer à l’obligation vaccinale.
la disposition du droit local en matière de maintien de salaire en cas d’absence due un évènement indépendant de la volonté du salarié pourrait aussi être développé devant une juridiction ad-hoc ? merci pour votre retour.
Bien cordialement
Bonjour,
Je suis à la recherche d’informations sur la durée du préavis pour une démission en Alsace et je trouve beaucoup d’informations contradictoires. Pourriez vous me guider sur la façon d’avoir une réponse sûre?
Je suis vétérinaire salariée en Alsace depuis 5 ans dans une clinique privée, et je cherche à savoir si mon préavis est de 15 jours, 4 semaines (je suis rémunérée tous les mois) ou 3 mois comme le stipule ma convention collective.
Merci de votre retour
Bonjour,
Je suis salariée d’une entreprise du limousine mais mon poste est basé en home office à Strasbourg. Après demande auprès de la CPAM j’ai pu garder mon régime locale.
J’ai été en arrêt maladie 4j la semaine dernière et sur mon attestation de paiement d’indemnité journalière il est indiqué que j’ai des jours de carence.
Est ce normal que je ne puisse pas bénéfice de 0 carence alors que je suis au régime local ?
Merci d’avance pour votre aide.
Bonjour,
Je réside en Alsace mais mon employeur est en région parisienne. Ai-je droit aux 2 jours fériés supplémentaires ?
Je vous remercie
Bonjour, non vous n’y avez pas le droit. Il faut que ce soit l’entreprise ou l’employeur qui soit en Alsace Moselle car elle cotise pour le droit local.
Votre employeur était en région parisienne, elle cotise pour droit général
Bonjour si mon lieu de résidence est en Alsace mais que mon entreprise se trouve en Eure et Loire. Bénéficie t on des 2j de congés supplémentaires ainsi que du maintien de la sécurité sociale à 90%
Bonjour, non. Pour avoir le droit local à la CPAM ainsi que les jours fériés, il faut que l’entreprise soit basée en Alsace Moselle. Et non le salarié
J’ai un enfant de plus de 16 ans qui a été victime d’un accident de la route et qui est en centre de rééducation
Combien de jours puis-je bénéficier pour enfant malade avec le droit local Alsace Moselle ?
Bonjour,
En cas de clause de non concurrence, celle-ci doit être renoncé durant le préavis par l’employeur ? Si elle est renoncé après le préavis, l’employeur ne doit-il pas payer l’indemnité ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Je suis secrétaire dans un cfa privé à Mulhouse
Je suis en arrêt maladie depuis le 17 janvier 2024 suite à ma grossesse.
Mon employeur a stoppé mon maintien de salaire pour le salaire du mois de mars. A t-il le droit ?